Relation de l'exode jusqu'en Russie

Relation sur mon séjour en exil
et l'exode des religieux jusqu'en Russie
Par un novice de la Valsainte de 1797 à 1800
Frère Jérôme était un noble engagé avec son père et son frère dans l'armée de Condé pour combattre les armées révolutionnaires françaises. Il suivit son frère qui voulait ese faire moine. Tous deux entrèrent à la Valsainte en 1797. Après quelques mois, Fr. Jérôme fut envoyé à la fondation pour les moniales à Sembrancher en Valais, les moines y avaient construit les bâtiments et assuraient des services pour elles.
En février 1798, les révolutionnaires français envahirent le pays et obligèrent les autorités valaisannes à expulser immigrés français, moines et moniales. Les moniales partirent du Valais en plusieurs groupes. Les premiers réussirent à passer par Vevey, Fribourg, Berne pour rejoindre Constance. Les Français ayant envahi le Bas-Valais, ils interdisaient le passage aux dernières moniales et aux moines encore à Sembrancher. En plein hiver il fallut emprunter le cos du Simplon, descendre vers le Lac Majeur, remonter par le San-Barnardino pour rejoindre la Suisse et la ville de Constance où les différents groupes partis de la Valsainte s'étaient donné rendez-vous. Ensuite fuir vers l'est jusqu'en Russie (Ukraine actuelle).
Fr. Jérôme de santé fragile ne put supporter un tel régime et sortit de l'Ordre avant d'avoir pris un engagement définitif. Il revint en France, se maria, eut 3 filles qui devinrent religieuses et pour elles il écrivit ses mémoires en 1839.
L'original est perdu, mais une copie en avait été tirée vers 1930 et se trouve aux Archives de Tamié.
Les Français ayant envahi le Bas-Valais, ils interdisaient le passage aux dernières moniales et aux moines encore à Sembrancher. Il leur fallut faire un très grand détour à cause du relief pour gagner Constance
Le moment du départ était arrivé. Nous étions dans la seconde semaine du carême 1798. Écrivant ceci en 1839, vous me pardonnerez d’avoir oublié la date précise. Nous entendîmes parler à la porte extérieure, ce qui est remarquable dans une maison de silence perpétuel. C’était le signal du départ. En effet, nos muletiers étaient arrivés et ne paraissaient pas disposés à attendre patiemment dans les neiges, aussi nous ne tardâmes pas à descendre la fameuse trappe dont j’ai déjà parlé. L’échelle nous remit sur la terre ferme, nous montâmes sur des mulets assez mal harnachés et nous voilà en route. Nous passâmes par Martigny et, suivant le pays du Valais, nous nous dirigeâmes vers le Simplon, montagne remarquable par son élévation et qui sépare la Suisse de l’Italie.
Le voyage pour un trappiste, loin d’être pour lui un obstacle aux réflexions sérieuses, doit les favoriser s’il est exact à [97] se conserver dans la modestie qui lui est prescrite à l’égard de tous les sens. En effet, il ne voit rien, si ses oreilles sont forcées d’entendre quelque chose de nature à distraire, il doit en détourner son attention sans efforts violents, il est vrai, mais l’habitude du recueillement le lui rend un besoin. La conduite de nos mulets n’était pas pour nous un sujet de dissipation. On les laisse dans une telle liberté, tout en marchant sur le bord des précipices, qu’ils n’ont qu’un simple licol dont la longe demeure attachée à la selle pendant la course.
Quelles amples matières à réflexions n’avais-je pas ! Je pouvais m’y livrer avec d’autant plus de facilité qu’aucune action extérieure n’occupait mon esprit. Nous allions au petit pas, l’un après l’autre, dans un sentier fort étroit, tracé dans des neiges fort épaisses, sans pouvoir réciter nos offices, le froid extrême ne nous permettant pas de nous servir de livres pour remplir ce devoir que nous étions obligés de remettre à la fin de la journée. Le chapelet était la seule prière vocale qui fût possible dans une marche aussi pénible. Quelques efforts que je fisse pour retenir mon imagination s’échappant sans cesse, elle me représentait les différentes circonstances où je m’étais trouvé depuis mon enfance. Mon cerveau, vidé par la faim dévorante que j’éprouvais, me fournissait des idées non moins burlesques qu’extravagantes, excitant en moi des rires involontaires. Je me voyais quelques fois à l’armée, manquant [98] de tout en pleine retraite, d’autres fois, ce qui était encore plus fâcheux, ma mémoire me remettait sur les lèvres différents couplets de chansons militaires dont je n’avais conservé le souvenir que par l’impression pénible que j’avais éprouvée dans le temps en les entendant chanter.
Je n’avais pas seulement à lutter contre la faim et l’âpreté du froid, mon excessive maigreur me rendait très pénible l’exercice de la selle où il fallait demeurer assis toute la journée sans descendre, ma faiblesse étant telle que je ne pouvais suivre le pas de notre petite caravane qui était cependant loin d’être accéléré. J’avais encore à lutter contre le dégoût de ma position, je voulais fuir le monde et je me voyais condamné à parcourir, d’une manière aussi incommode, peut-être une partie de l’Europe, sans avoir d’autre repos que celui qu’on peut espérer trouver dans de mauvaises auberges, étant exposé à la dérision des hérétiques et des mauvais chrétiens, ce qui s’est assez souvent vérifié.
Je n’avais pas alors d’expérience de la vie. Je conservais encore certaine idée d’un bonheur dont je pouvais jouir ici-bas et mon pauvre cœur se soulevait contre un régime si révoltant pour la nature. Il me semblait être un trop rude châtiment pour les plus grands crimes. Mon imagination fatiguée par des pensées si décourageantes, que je rejetais avec effort, me plongeait dans un grand affaissement moral, me suspendant pour un temps la faculté de penser.
Après cette espère de repos d’inertie, le divin Soleil de Justice laissait échapper [99] sur mon âme accablée un rayon de lumière qui la ranimait. Je voyais alors la main protectrice de la divine Providence qui nous conduisait dans un lieu de rafraîchissement et de paix et ne nous demandait qu’un entier abandon. Je considérais aussi le peuple d’Israël se dirigeant sous la conduite de Moïse vers la Terre Promise. Je tremblais pour moi-même au souvenir des châtiments terribles que Dieu, non moins juste que bon, infligea dans le désert à ce peuple murmurateur. Je me reprochais alors les égarements de mon imagination. J’acceptais en réparation les peines de tous genres que je souffrais et aurais à souffrir. Je formais une ferme résolution de ne penser au mal présent que pour mériter, par la patience, les récompenses promises à la persévérance.
Après avoir passé la journée tout entière à gravir des montagnes de neige, nous arrivâmes, vers le déclin du jour sur le Simplon, au sommet duquel est un petit village, terme de notre premier jour de marche. Je descendis avec peine de ma monture, ayant tous les membres dans un engourdissement tel que je ne pouvais me mouvoir que très difficilement. Il fallut pourtant monter dans une grande chambre où il n’y avait pour tous meubles que quelques chaises et un grand poêle bien chauffé, d’autant plus nécessaire que l’air est extrêmement vif sur cette haute montagne. N’oublions pas que nous étions en carême et que nous avions fait une terrible journée sur une soupe à l’eau et au sel, suivie d’une portion de gros légumes apprêtés de même, lequel repas unique avait été pris la veille à quatre [100] heures et demie, car les voyages n’exemptent pas de la pénitence accoutumée. Aussi ne vous parlerai-je plus du régime animal tant pour les vivres que pour le lit. Il me suffira d’ajouter que lorsque nous trouvions du plancher pour nous étendre nous nous regardions comme chez nous.
J’étais tellement glacé pendant la dernière course que je n’étais pas encore réchauffé entièrement lorsqu’il fallut prendre le repos de la nuit, ce qui me donna l’idée de me caser dans un petit coin qui se trouvait entre le poële et la relais du bâtiment, ressemblant assez à la ruelle d’un lit. J’y dormis fort lourdement mais à mon réveil, je me trouvai comme un hareng saur, tant l’humide radical avait été en moi rapidement absorbé. Il fallait cependant satisfaire aux exercices du jour et, sans prendre même un verre d’eau, fournir une course qui ne devait se terminer qu’au coucher du soleil, encore non levé. Maintenant qu’il y a environ quarante-deux ans que cela est passé, le seul souvenir de tout ce que je souffrais alors me fait frissonner et je ne peux pas comprendre comment nous avons résisté à de telles épreuves. Grand Dieu, que j’ai dégénéré en force, en vertus et surtout en amour pour vous !
Le jour précédent nous avions presque continuellement monté, il fallut descendre le fameux Simplon sur lequel nos gros habits nous semblaient bien légers. Nous traversâmes ensuite une vallée où nous eûmes une très douce température, aussi je m’aperçus des progrès de la végétation : des berceaux de vignes ombrageaient [101] la route et la suave odeur de la violette parfumait l’air plus approprié à nos poumons affaiblis. Nous arrivâmes de jour dans une petite ville de la Suisse Italienne où nous devions passer la nuit et d’où nous ne partîmes qu’après avoir fait la communion générale.
Pendant les deux premières journées, j’avais ressenti toutes les horreurs de la faim, aussi, avant le départ, me trouvant dans un épuisement total, je me décidai à faire connaître au RP Urbain, notre prieur, que j’étais absolument à bout, ce que le bon père n’eut pas de peine à croire, mais comme il ne faut rien perdre à la Trappe et qu’il faut regagner par l’humiliation tout ce qui peut manquer sous le rapport de l’austérité, après s’être moqué de moi, il me conduisit dans une chambre voisine où on faisait manger de la soupe à un certain nombre d’enfants qui faisaient, sous la conduite d’un frère du tiers-ordre, partie de notre caravane. Je fus donc mis en rang immédiatement après les enfants. Le bon frère m’administra une portion très copieuse qui trouva en moi tant de vide que peu s’en fallut qu’elle me descendit jusqu’aux talons. Quelques moments après ce réconfort, nous nous mîmes en route, mais comme il nous manquait un mulet, pour que tous nos bons pères fussent montés, notre père prieur vint me dire à l’oreille, par respect pour le silence, que nous n’aurions qu’une monture pour nous deux, ce qui m’inquiéta un peu, ce bon père étant d’une extrême faiblesse. Quant à moi, je ne me sentais pas, malgré mon déjeuner, capable de faire une demi lieue à pieds. Quoiqu’il en soit, [102] il voulut que je montasse le premier et nous partîmes.
Nous quittâmes donc notre ville hospitalière qui doit se nommer Domo d’Ossola. Nous y avions été aussi bien qu’un trappiste peut être en ce monde. Nous traversâmes une petite partie de son beau vallon mais après avoir passé une rivière assez large, nous rentrâmes dans les montagnes et dans les neiges. Toutes blanches qu’elles étaient, elles ne cessèrent pas de rembrunir les pensées en me resserrant les poumons. Je me laissai conduire comme un aveugle, ne voyant d’autre terme à ce pénible pèlerinage que la bienheureuse éternité, laquelle est effectivement le seul but où doivent tendre nos désirs. Marchant le dernier de la caravane, à l’exemple de la femme de Loth, je regardais souvent en arrière pour voir ce que devenait le bon père Urbain. Il marchait avec tant de courage dans les neiges assez peu frayées, qu’il nous suivait à très peu de distance. Je lui faisais des signes auxquels il ne répondait pas. Je pris le parti de l’attendre mais il me dit qu’il se portait bien, que lorsqu’il serait fatigué, il monterait à son tour. Le fait est qu’il ne monta sur le mulet que la valeur d’une demi-lieue quoique la course fut longue et très pénible.
Nous étions dans le pays des Grisons et sur le soir nous arrivâmes à Coireoù nous passâmes la nuit. Je regrette, chères filles, de ne pouvoir vous faire aucune [103] description d’un pays qui est fort curieux, mais n’oubliez pas qu’un trappiste affublé de son capuchon, doit être aveugle, sourd et muet. Peut-être même est-ce pour avoir trop vu, entendu et parlé que je n’ai point persévéré parmi ces bons pères !
Mais revenons à notre voyage dont je n’ai tenu aucun journal et dans le cours duquel j’ai été très mauvais observateur. D’ailleurs ma mémoire étant souvent en défaut, je ne peux guère parler que de ce qui m’a frappé davantage. Nous prenions notre direction vers l’Allemagne. Nous eûmes à franchir le mont Bernardino. Jusque là nous avions franchi à dos de mulet mais il nous fallut changer d’équipage. En sortant de l’auberge nous trouvâmes de petits traîneaux en forme de huches à pétrir le pain dans lesquels on ne pouvait placer qu’un voyageur. Ils étaient tous attelés d’un bœuf de la taille d’un fort chien de boucher. Nos trappistes prirent place sur ces mêmes traîneaux. Quant à moi, le RP me fit donner le seul mulet qui se trouvait là, avec ordre de prendre les devants pour aller disposer les vivres et le logement dans le premier village que je rencontrerais au bas de la montagne. Cette commission me fut sans doute assignée comme entendant un peu l’allemand.
Je pris donc la tête de la caravane, bien persuadé que j’arriverais beaucoup plus tôt à la couchée, ne pouvant croire que les traîneaux pussent aller aussi vite. Je suivis donc un étroit sentier au pas de ma monture qui ne gravissait qu’avec peine une montagne aussi ardue. J’observais de temps en temps la marche de la [104] colonne que j’avais laissée loin derrière moi et considérant la distance que j’avais déjà gagnée sur elle, je me persuadai que j’allais trop vite, ce que je voulais éviter pour ne pas être trop longtemps seul au milieu des protestants auprès desquels mon costume trappistal était une fort mauvaise recommandation. Je rencontrais souvent des parties moins raides où j’aurais pu hâter le pas, mais je ne me pressais pas et je perdis bientôt de vue nos bons pères. Après avoir marché plusieurs heures, toujours occupé à suivre le frayé dont on ne pouvait s’écarter sans s’exposer à se perdre dans les neiges, j’arrivai sur le sommet du Bernardino et je n’augmentai pas mon train lorsque j’entendis crier derrière moi. C’étaient, à mon grand étonnement, nos bouviers qui m’avaient rejoint et réclamaient le passage. Ils couraient d’une vitesse extrême. Je quittai avec empressement le sentier et mon mulet entra dans la neige jusqu’au poitrail. Lorsque le convoi fut passé, ce ne fut qu’avec peine, qu’en regrettant le temps perdu, je pus reprendre la voie étroite. Mon ambition eut été alors de suivre modestement la caravane, mais je vis qu’il fallait y renoncer, surtout en reconnaissant que le reste de la route n’était qu’une descente.
Nos bons pères arrivèrent au village où nous devions passer la nuit près d’une heure avant moi, mais ils n’en étaient pas beaucoup mieux. Je les rejoignis dans une assez mauvaise auberge, dans une salle basse où était le rassemblement de tous les survenants, en assez grand nombre, attirés sans doute par la [105] nouveauté du spectacle. Le pays était protestant et il n’y avait pas un individu qui parlât français. Je trouvai le père Urbain et ses dignes religieux resserrés les uns contre les autres à peu près comme des brebis dont le loup a forcé le parc, nous étions les seuls qui n’eussions pas la pipe à la bouche. Je m’approchai du RP qui me fit signe de me placer auprès de lui afin de lui servir de truchement. Il y avait assez longtemps que nos respectables religieux faisaient tapisserie dans un lieu inconvenant où se tenait le cabaret, lorsque j’allai, d’après le désir du prieur, demander à l’hôtesse une chambre haute où nous puissions être libres, à quoi cette protestante qui avait l’air d’une bonne personne, me dit qu’on s’occupait à débarrasser une grande place où l’on serait très bien.
Les moments nous paraissaient longs, tandis qu’ils semblaient courts à cette foule de spectateurs désœuvrés qui ne se lassaient de nous examiner avec une maligne curiosité. Ensuite chacun disait son mot avec d’autant plus de liberté qu’ils ne craignaient pas d’être compris. D’ailleurs le mépris que ces pauvres aveugles avaient pour nous les mettait fort à leur aise. Dans ces sortes de réunions, comme dans les cercles plus policés, il y a toujours quelqu’individu qui tient le dé. Effectivement un, par son ton assuré aussi bien que par son geste animé, donnait le bon ton à cette multitude qui applaudissait à tous ses mauvais propos. Je n’en citerai qu’un pour donner une idée des autres : “Que fait cette engeance dans ce monde, si elle dépendait [106] de moi, j’aurais bientôt déchargé la terre…” Heureusement, on nous avertit que nous pouvions monter, ce qui fit à tous un grand plaisir car quoique je fusse le seul qui comprit à peu près nos orateurs, je ne doute pas que tous non bons pères ne souffrissent beaucoup dans cette dégoûtante tabagie. Le mal passé n’est que songe, surtout pour des personnes qui n’en connaissent d’autre que le péché. Nous avions à gémir, il est vrai, sur l’aveuglement de tant d’âmes vivant dans l’hérésie, mais nous avions du moins la consolation de participer aux opprobres de Jésus Christ.
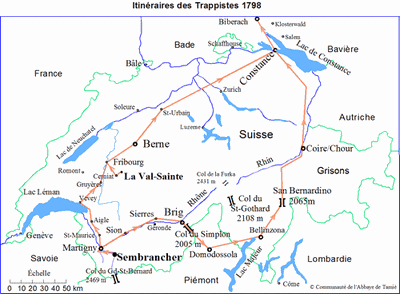
Si vous désirez obtenir le texte complet, à usage strictement privé, adressez-vous au webmestre

